note Note générale
Le design est politique
J’observe que le design des plateformes En commun dépasse la dimension esthétique. Le choix des fonctions, les modalités de traitement des données, l’organisation des contenus, l’apparence visuelle et la navigation, par exemple, reposent sur des décisions qui ne sont pas sans conséquences. L’impact est si important que le design implique des responsabilités qui devraient être partagées. C’est un travail minutieux qui doit être mené par des professionnel·les, mais aussi un processus qui doit être transparent, démocratisé et appuyé sur des orientations discutées collectivement.
Au moment où s’amorce une réflexion collective sur le design des plateformes En commun, cette note propose des observations sur l’impact du design et des pistes pour un design démocratisé et éthique. La conception du design de Passerelles, de Praxis et éventuellement de Babillard vise à répondre à des enjeux pratiques, tels que la facilité de se repérer et d’utiliser ces outils, mais aussi des enjeux plus profonds, comme les principes et les valeurs sur lesquels l’action collective s’appuie.
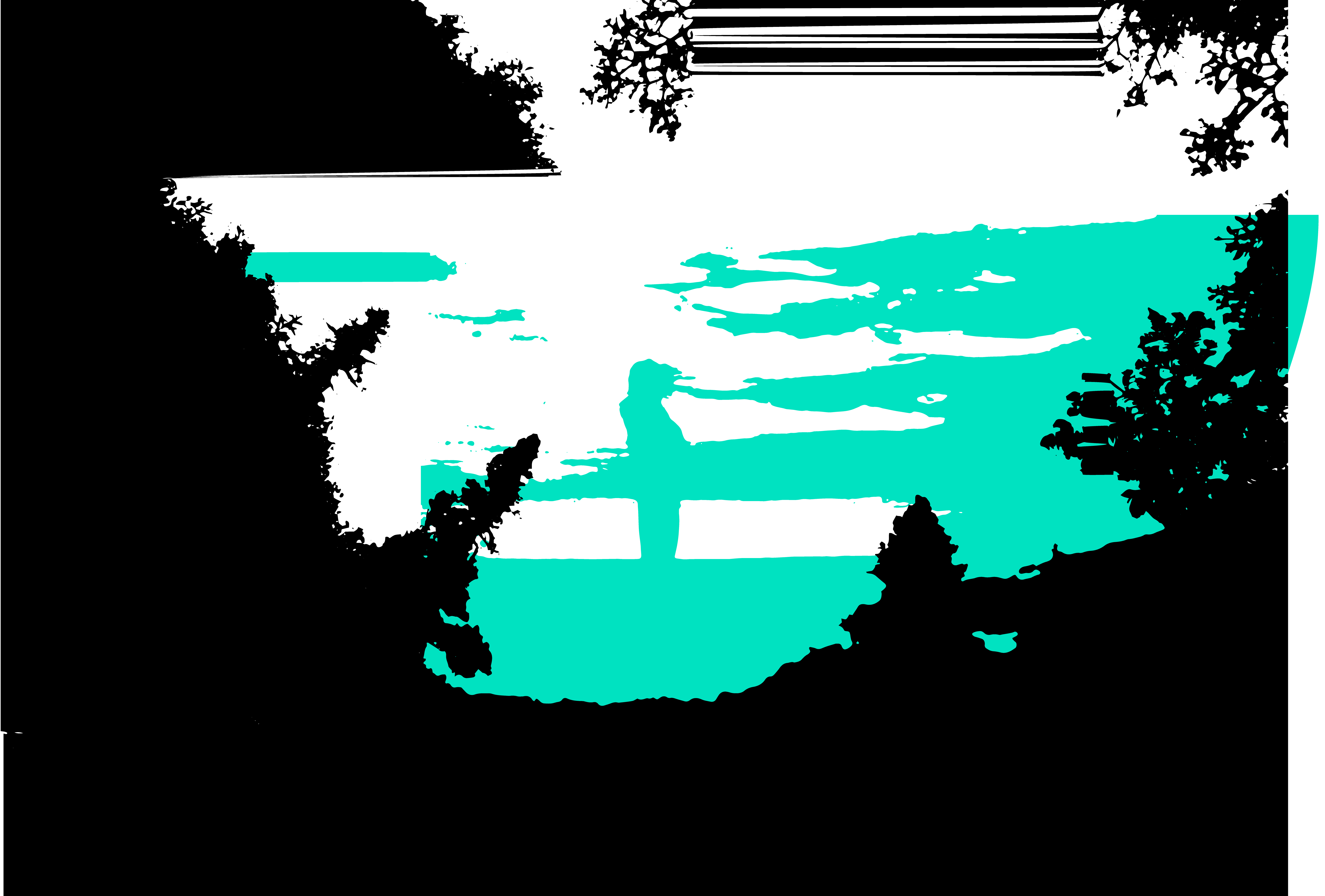
L’impact du design
Les intentions qui orientent le design des interfaces influencent notre utilisation des outils numériques. Le choix des fonctions, leur utilisation et l’organisation de ces environnements affectent aussi la manière de nous informer, d’apprendre, de créer, de réfléchir, de discuter, de délibérer, de militer et de vivre ensemble. De plus, il est démontré que les outils numériques affectent notre santé mentale et nos facultés cognitives. Certains affirment par ailleurs qu’ils sont aujourd’hui devenus un rouage central du capitalisme (voir Jonathan Martineau et Jonathan Durand Folco dans Le capital algorithmique).
Ainsi, la conception du design des outils numériques est nécessairement politique.
Si le design des médias d’information, messageries, réseaux sociaux, logiciels en ligne, applications, moteurs de recherche, bases de connaissances ou modèles de langage influencent nos usages, nos comportements, notre bien-être et notre système économique, il y a lieu de questionner les influences qui entrent en jeu. Comme la plupart des outils que nous utilisons sont commerciaux, leur design est d’abord orienté par la volonté de générer de la valeur, notamment à travers la monétisation de données personnelles et la captation de l’attention. Chaque fois que nous les utilisons, notre regard, nos gestes et nos comportements sont guidés par un interface et des algorithmes dont la conception est réfléchie pour optimiser le rendement économique.
On en voit aujourd’hui des conséquences importantes dont l’anxiété, la santé mentale des jeunes, la surcharge cognitive, la circulation des fausses informations, la surveillance, la polarisation et l’effritement de la démocratie, en plus des impacts économiques, politiques et écologiques.
Pour un design démocratisé et éthique
Je ne discuterai pas ici des avenues possibles pour encadrer les plateformes commerciales, sujet incontournable et largement abordé sur d’autres tribunes. Je propose plutôt certaines pistes de réflexions pour mieux orienter le design des solutions numériques qui s’inscrivent dans un autre imaginaire, qui se positionnent en résistance face au modèle dominant et qui cherchent à nourrir la justice sociale et écologique. Plus précisément, les pistes ici proposées visent à contribuer à la réflexion sur le design des plateformes En commun.
- Je propose d’abord de reconnaître collectivement le caractère politique du design. Chaque choix, qu’il soit mineur ou profond, esthétique ou structurel, fonctionnel ou architectural, aura des conséquences sur notre rapport à l’outil et peut avoir des effets sociaux. Ainsi, chaque choix doit s’appuyer sur des intentions, principes et valeurs clairement affirmés.
- Comme le design est politique, il doit être démocratisé. Cela ne signifie pas que chaque utilisateur·trice doit donner son accord ou avoir les compétences techniques nécessaires pour comprendre la programmation. Cela signifie que chaque personne qui s’y intéresse devrait pouvoir accéder à l’information, participer aux discussions de fond sur la vision, contribuer aux réflexions sur les enjeux et orientations, émettre des idées et participer à leur mise en œuvre, et donc influencer le design. Cela implique de prendre le temps de constituer et de prendre soin de la communauté, de partager les informations et connaissances nécessaires et de discuter collectivement.
- Sortir de l’imaginaire marchand, s’inscrire dans un modèle de soutenabilité des communs et favoriser le commoning tout en renforçant le positionnement éthique.
- Ne pas hésiter à prendre un pas de recul pour analyser plus en profondeur les besoins, les pratiques numériques actuelles, les usages souhaités, les freins potentiels et les conséquences possibles. La conception ne devrait pas s’appuyer sur la compréhension d’un petit groupe collé sur le projet; elle doit s’appuyer sur une recherche approfondie menée auprès d’une diversité de personnes, respecter les principes clairs, et être validée par discussion avec la communauté. Cela implique de prendre le temps, voire de retarder certains développements pour mieux assurer leur pertinence, leur ancrage et leur adéquation avec les aspirations sociales des utilisateur·trices.
- Rester vigilant·es et autocritique en tout temps. Cela peut impliquer de revenir sur des pas réalisés, admettre des erreurs et réviser certains morceaux.
Invitation à participer à la conception
La communauté autour des plateformes En commun est active, ce qui est rassurant et stimulant. Il y a là un réel potentiel de mobiliser l’intelligence collective pour réfléchir aux enjeux actuellement identifiés et pour orienter les développements à venir tout en gardant en tête les dimensions politiques inhérentes.
Au moment d’écrire ces lignes, deux grands chantiers de design s’ouvrent. D’une part, des améliorations doivent être apportées aux plateformes En commun pour améliorer la compréhension, la navigation et l’expérience générale. Vous êtes nombreux·euses dans la première année d’existence d’En commun à avoir contribué à une meilleure analyse de la situation actuelle et à avoir émis des pistes concrètes. D’autre part, nous envisageons de développer une troisième plateforme, Babillard, pour répondre à des besoins régulièrement exprimés et pour contribuer à l’adoption d’En commun. Comme l’ajout d’une plateforme peut à la fois amplifier les enjeux actuels de navigation et contribuer à l’identification de solutions, les deux chantiers sont intimement reliés.
Nous vous invitons à participer à ces chantiers qui sont loin d’être anodins puisqu’ils sont fondamentalement politiques. La manière de concevoir des outils pour soutenir la collaboration, la circulation des connaissances et l’organisation de l’action collective s’appuient sur des valeurs, une vision et des aspirations. C’est donc une invitation à réfléchir aux plateformes En commun et plus fondamentalement aux manières dont nous voulons agir ensemble pour répondre aux enjeux actuels et pour mener des transformations systémiques.
Ce texte est inspiré de discussions tenues entre autres avec Marie-Soleil L’Allier et Vincent Chapdelaine.
note Note(s) liée(s)
 12 avril 2024
12 avril 2024
Déjà un an: joyeux anniversaire En commun
12 avril 2024 20 mars 2024
20 mars 2024
Sortir de l'imaginaire marchand
20 mars 2024 14 novembre 2023
14 novembre 2023
Un calendrier comme nouvelle plateforme En commun?
14 novembre 2023 10 juillet 2023
10 juillet 2023
Le bien-être numérique pour lutter contre l'hyperconnectivité
10 juillet 2023 18 mai 2023
18 mai 2023
Modèle de soutenabilité des communs
18 mai 2023 26 mars 2018
26 mars 2018
Passerelles (plateforme numérique)
26 mars 2018 26 mars 2023
26 mars 2023
Plateformes En commun
26 mars 2023 26 mars 2023
26 mars 2023
Praxis (plateforme numérique)
26 mars 2023bookmark Terme(s) relié(s)
Carnet(s) relié(s)
 file_copy
5 notes
file_copy
5 notes
Joël observe
file_copy 5 notesAuteur·trice(s) de note
Contacter l’auteur·trice Discuter de la note Plus d’informationsPublication
11 juin 2024
Modification
12 juin 2024 11:15
Visibilité
public
Pour citer cette note
Joël Nadeau. (2024). Le design est politique. Praxis (consulté le 30 juin 2024), https://praxis.encommun.io/n/umEO-dD4eWhFwarDIMqr5-SVyA4/.
shareCopier
